En France, l’union n’est légale entre apparentés qu’à partir du moment où ils le sont au 4e degré selon le code civil. Quelle en est la raison ?
Regardons du côté de la génétique. Chacun de nos gènes, se trouvent en 2 exemplaires dans nos cellules : ce sont nos allèles. L’un est d’origine maternelle, l’autre paternelle. Lorsqu’un de nos allèle porte une mutation, il arrive souvent qu’elle ait un effet récessif et donc passe inaperçue. L’allèle non muté prend donc le dessus et empêche l’apparition d’un phénotype lié à une maladie. Le problème de la consanguinité serait alors que l’on augmenterait les chances d’obtenir 2 versions non fonctionnelles d’un gène étant donné que les parents pourraient avoir hérité de la même mutation d’un ancêtre commun. Seulement, certaines cultures n’interdisent pas cette pratique. La consanguinité est donc souvent vu comme un tabou culturel.
Si la consanguinité est un facteur de maladie au sein des populations, il serait possible qu’un caractère permettant de l’éviter confère un avantage évolutif et soit sélectionné au cours de l’évolution humaine. Mais ne serait-ce pas déjà le cas ? Pour répondre à cette question, des chercheurs se sont intéressés au complexe majeur d’histocompatibilité (MHC), essentiel à notre système immunitaire pour la reconnaissance du soi et du non soi. Cet ensemble de gènes localisés sur le chromosome 6 chez l’humain, n’est pas identique d’un individu à un autre (sauf pour les vrais jumeaux).
Pour commencer, une équipe suisse dirigée par Claus Wedekind, en 1995 a donc effectué une expérience qui consistait à faire sentir des tee shirt ayant été portés par des hommes à des femmes qui devaient choisir celui dont l’odeur les attirait le plus.

La préférence des femmes pour un partenaire dissimilaire au niveau du MHC a alors été mise en évidence.
En 2019, une étude de RaphaëlleChaix, ClaireDandine-Roulland, RomainLaurent, IreneDall’Ara et Bruno Toupance a continué dans cette voie et a effectué des analyses sur des populations humaines de différentes ethnies. Les résultats sont que dans des communauté où les couples se forment pour la plupart du temps librement, sans favoriser un type d’individus, les MHC ont tendances à être éloignés entre deux partenaires. Tandis que dans les pays qui favorisent les mariages “consanguins” comme les Yoruba ou des populations d’Israel, aucun résultat significatif ne permet de constater des MHC distants. Ces résultats soutiennent alors l’idée que le MHC influence le choix du conjoint en absence de contraintes culturelles. Deux hypothèses entrent alors en jeu. La première étant que des parents avec des MHC éloignés permettent un plus grand répertoire de récepteurs MHC et une meilleure réponse immunitaire. La seconde étant de limiter la consanguinité sur l’ensemble du génome. Ces deux théories peuvent être complémentaires et pour le moment, aucune ne prend le dessus sur l’autre.
Éviter la consanguinité serait donc un phénomène culturel lié à des tabous et à la connaissance de risques associés. Mais il se peut également qu’un phénomène d’adaptation ait été mis en place, permettant de l’éviter naturellement et ainsi, d’augmenter les chances d’obtenir des descendants “viables”.
Article écrit par Sonia Mignon
Bibliographie :
- Présentation “L’hypothèse du complexe majeur d’histocompatibilité MHC” par Raphaëlle Chaix.
- SHERIDAN Eamonn, WRIGHT John, SMALL Neil, CORRY Peter, ODDIE Sam, WHIBLEY Catherine“Risk factors for congenital anomaly in a multiethnic birth cohort: an analysis of the Born in Bradford study” ; Juillet 2013 : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61132-0/fulltext
- CHAIX Raphaëlle, CAO Chen, DONNELLY Peter; “Is Mate Choice in Humans MHC-Dependent ?” – Septembre 2008 – WEDEKIND Claus, SEEBECK Thomas, BETTENS Florence, PAEPKE Alexander.J ; “MHC-dependent mate preferences in humans”
- DANDLINE-ROULLAND Claire, LAURENT Romain, DALL’ARA Irene, TOUPANCE Bruno, CHAIX Raphaëlle; “Genomic evidence for MHC disassortative mating un humans” – 2019
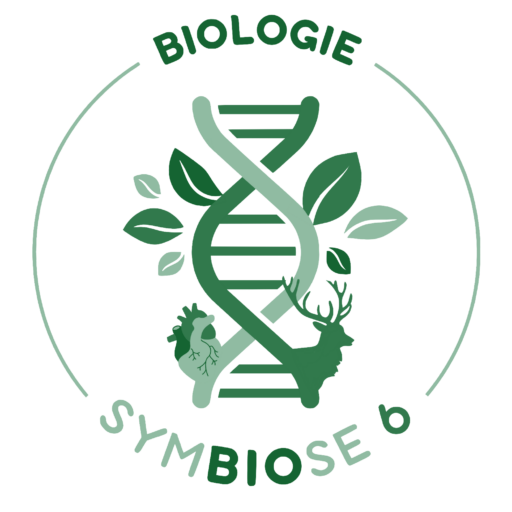
Comments are closed